Les geysers en Islande
L'AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE DE L'EAU
Comment l'eau est-elle chauffée et pourquoi est-elle si particulière?

L'eau qui jaillit du geyser est une eau très chaude, pouvant atteindre jusqu'à 200°C et tout autant partiulière. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, l'eau bouillante est associée à une pression très basse et cela explose littéralement. Ce phénomène expliqué, nous allons maintenant nous intéresser à la façon dont cette eau est chauffée en Islande. Effectivement cette terre de glace cache bien son jeu en possédant des ressources thermiques considérables.


Le cycle éruptif d'un geyser répond à une équation assez simple. L'eau est surchauffée en profondeur, dans le réseau de cavités créé par l'activité de dissolution des eaux hydrothermales. Ensuite, quand la pression au sein du volume d'eau surchauffée atteint une valeur qui permet de contrebalancer le poids de la colonne d'eau et les pertes de charge, l'ébullition débute et le geyser entre en éruption. Le cycle de renouvellement du phénomène, la durée de l'éruption ainsi que les volumes en jeux sont variables en fonction de l'état du réseau souterrain, de son volume et de son interconnexion, le tout sous le contrôle du gradient géothermique local. Cette eau surchauffée plus légère aura tendance à remonter et passera en phase gazeuse dès que la pression le permettra.
L’Islande est un pays recouvert de volcans où plus de 200 volcans y sont nés depuis l’époque glaciaire. Près de 130 éruptions ont été décrites dans les temps historiques. Au total, les laves émises couvrent environ 35.000 km2. Il y a une éruption tous les quatre à six ans environ. Près du tiers des laves basaltiques émises dans le monde depuis l’an 1500 proviennent de cette île. Ainsi, comme le montre la carte géologique ci-contre, le sol de l'île est constitué à 90% de roches volcaniques. Ces-dernières sont en réalité du magma refroidit après avoir émergé à la surface. Le reste de ce magma est toujours en fusion sous l'Islande, c'est donc de là que proviennent toutes ces ressources énergétiques et thermiques.


Comme les roches volcaniques sont très poreuses, l'eau de pluie s'infiltre dans le sol. Au contact de ce sous-sol, l'eau se réchauffe et la température peut atteindre 200°C dans le geyser. Entre le magma très chaud et l’eau froide un transfert thermique entre en jeu. Quand deux corps sont en contact et qu’ils ont des températures inégales ils échangent de l’énergie, c’est le transfert thermique. En réalité, le corps le plus chaud cède de l’énergie au plus froid, ici le magma cède de l’énergie à l’eau. La température étant une grandeur liée à l’agitation microscopique des molécules, un afflux d’énergie va engranger une hausse de l’agitation et donc une hausse de la température du corps ou encore un changement d’état. Ainsi, lorsque deux corps de températures différentes sont en contact, le plus froid va se réchauffer voir changer d’état avec l’énergie cédée par le corps le plus chaud.
Lors d’un changement d’état le transfert thermique se traduit par la relation:
Q=m.L
Lors d’une simple variation de température le transfert thermique s’exprime par la relation:
Q=m.c.ΔT
L'énergie Q (en J) dépend donc soit du produit entre la masse m (en kg) et l'énergie massique de changement d'état du corps L (en J.kg-1) soit du produit entre la masse m (en kg), la capacité thermique c (en J.kg-1.°C-1) et la différence de température entre les deux corps ΔT (en °C).
Ainsi, la roche chaude arrive au contact de l'eau et un transfert thermique par contact a lieu. La roche chaude cède de son énergie à l'eau qui, grace à cette énergie, augmente l'agitation de ses molécules et sa température jusqu'à atteindre 200°C dans des conditions optimales de pression. Mais ce transfert de chaleur est-il la seule interaction entre le magma et l'eau? Pourquoi cette dernière est-elle si particulière?

Au contact des roches volcaniques sous-terraines, l'eau du geyser reçoit une énergie qui entraine une agmentation de sa température. Nous avons donc une eau extrêmement chaude puisque la température du magma est supérieure à 650°C. Mais par delà de cette chaleur, l'eau surprend aussi par sa couleur. Il n'est pas rare de voir ces splendides zones de bleu qui font penser aux plus belles îles du monde. Mais comment cette eau parvient-elle à cette coloration? Comment se fait-il que cette eau bouillante aie cette couleur bleue si paisible et douce? Et bien cette couleur est encore dûe à cette intéraction entre les roches magmatiques et l'eau. Pour en comprendre l'origine il faut donc regarder de plus près la composition de ces roches et étudier les minéraux qui y sont présents.

Le schéma ci-decontre montre les différentes roches qui composent la Terre sous l'océan. Ormis les sédiments, toutes les roches de la croûte océanique sont issues de magma quand se dernier se refroidit. Les péridotites du manteau supérieur quant à elle ne sont pas issues du refroidissement du magma.
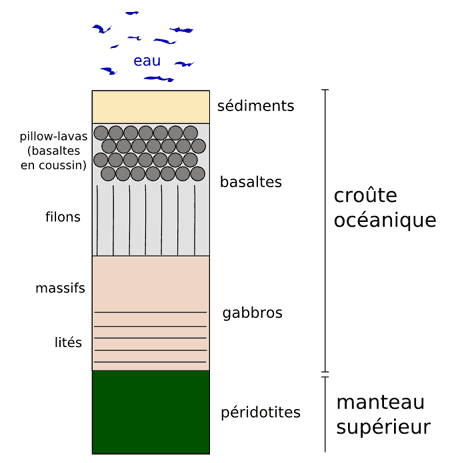
Afin d'étudier la composition chimique des roches volcaniques, nous allons étudier celle du gabbro et du basalte, les roches d'origine magmatique de la croûte océanique.



Ce document est un tableau présentant les compositions chimiques des deux roches magmatiques que nous avons vu, le baslte et le gabbro.
On constate que le gabbro et le basalte ont presque la même composition chimique. Par exemple le gabbro contient 49,00% de SiO2 et 15,78% d’Al2O3 et le basalte contient 49,20% de SiO2 et 15,74 d’Al2O3. Au contraire, nous n'avons pas les mêmes pourcentages concernant la composition chimique entre la péridotite et le basalte, gabbro.
Mais ce qui frappe le plus et qui nous intéresse le plus c'est leur teneur en dioxyde de silicium, ce fameux SiO2. Il représente près de 50% de leur composition chimique. Mais qui est-il ce dioxyde de silicium?
 |
|---|
 |
 |
 |
Agancement de la molécule de dioxyde de silicium.
Le dioxyde de silicium est un composé chimique formé d'une proportion d'un atome de silicium pour deux atomes d'oxygène et dont la formule peut s'écrire SiO2. On l'appelle aussi la silice sous sa forme naturelle.
Le dioxyde de silicium existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes de silice et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al, Fe, Mg, Ca, Na, K...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. Le dioxyde de silicium libre est également très abondant dans la nature, notamment sous forme de quartz et de calcédoine. Il représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale.
C'est finalement ce SiO2 qui va donner cette couleur bleue à l'eau du geyser. Il provient de la roche qui chauffe l'eau et se retrouve sous forme de micro-particules avec elle. En réalité, la silice se dissout très partiellement dans l'eau pure sous la forme de Si(OH)4 l'acide silicique, c'est pour cela que le passage de roche à eau se fait si facilement. Dans l'eau, l'acide silicique forme des suspensions colloïdales qui sont responsables de l'apparente opacité de l'eau, c'est le cas dans l'eau des geysers comme celui de Geysir en Islande. On appelle colloïdes les particules qui diffusent préférentiellement les courtes longueurs d'onde car en effet la couleur bleue est le résultat de la diffusion de la lumière sur ces fines particules de silice en suspension.

Cette première photographie montre une vue plongeante de cette vasque où l'on peut admirer la beauté de la silice qui forme une "écume" blanche autour du conduit. L'eau se refroidit en sortant, et ce refroidissement entraîne une diminution de la solubilité de la silice. Cette silice se dépose donc en tapissant les parois de la source d'une roche nommée geyserite, qui n'est qu'une forme de silice amorphe hydratée.

Cette seconde photographie montre une autre vasque du site islandais de Hveravellir : dans celle-ci la teneur en colloïdes est plus forte, l'eau n'est plus transparente mais devient laiteuse tout en gardant sa couleur bleue.
Conclusion Partielle:
Ainsi, l'eau des geysers est une eau fortement chauffée par les roches magmatiques en présence. Ces-dernières sont riches en un dioxyde de silicium (SiO2) très soluble dans l'eau. C'est ainsi que des micro-particules de silice se retrouvent en suspension dans l'eau et interagissent avec la lumière extérieure afin de renvoyer à notre oeil cette magnfique couleur bleutée. Ces phénomènes sont tous en lien avec le magma souterrain, mais que vient-il faire ici ? Quel est son rôle dans la formation des geysers ?

