Les geysers en Islande
L'ISLANDE, GÉOLOGIQUEMENT UNIQUE
Pourquoi ce phénomène apparait en Islande?


L'islande est un pays insulaire d'envion 103000km². Elle comporte 97 % de Terre et 3 % d'eau. Elle représente 1/5 du territoire français. L'île se situe au cœur de l'océan Antlantique Nord, à l'Ouest de la mer de Norvège et au sud du détroit du Danemark. Elle est à environ 300 kilomètres à l'Est des côtes du Groenland et à 900 kilomètres à l'Ouest de la Norvège, se trouvant juste en dessous du cercle polaire. Bien sûr elle fait partie du continent Nord Européen.
D’un point de vue géologique le pays est à cheval sur deux plaques tectoniques : la plaque eurasiatique et la plaque nord-américaine. On appelle ce phénomène un rift, une immense fracture de la croûte terrestre qui sépare les plaques tectoniques.
L’Islande actuelle illustre l’interaction entre un point chaud et une dorsale.

Les plaques tectoniques sont des portions mobiles de cette lithosphère. Quinze plaques majeures ont été identifiées à la surface de la Terre, auxquelles sont associées un nombre plus important de plaques mineures. Ces plaques ont des mouvements relatifs différents, ce qui génère différents types de limites entre elles : convergentes, divergentes ou coulissantes. Au niveau de ces limites, de nombreux phénomènes géologiques, tels que l'activité volcanique, la formation de chaînes de montagnes. C'est ce qui s'est passé en l'Islande.
Lorsque l’on observe l’intérieur du globe, on se rend compte qu’il est organisé en plusieurs couches aux caractéristiques différentes. Le coeur du globe est composé de deux noyaux, internes et externes. Le noyau interne est une sphère de roche ductile qui a pour centre celui du globe à 6371 km de profondeur et s’étend sur 800km, jusqu’à 5100 km sous la surface. Ensuite, le noyau externe prend le relais avec une roche liquide, de 5100km à 2900km de profondeur. Par dessus ces deux noyaux il existe un manteau terrestre divisé en deux manteaux, l’inférieur et le supérieur. A la surface, une petite première couche est appelée lithosphère. Elle est rigide et repose sur une zone de fusion partielle.

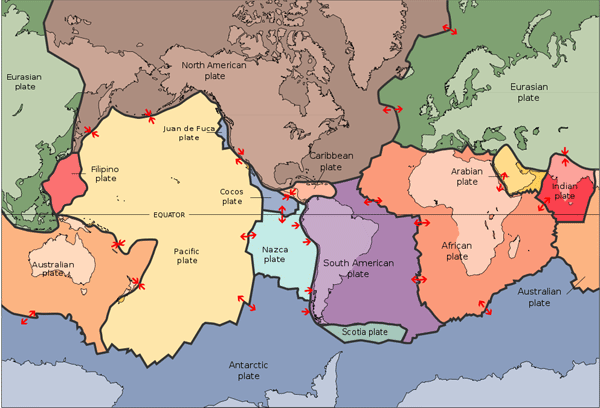

Dans un corps opaque supposé non déformable la chaleur se transmet par conduction. Si un corps est chauffé par le bas et refroidi par le haut, les zones denses seront en haut et les légères en bas. Ainsi, la matière froide du haut aura tendance à descendre et la matière chaude un peu moins dense du bas aura tendance à monter. C'est le phénomène de la convection thermique, que l’on retrouve dans le manteau terrestre sous le nom de convection mantellique. Elle est considérée comme le moteur profond de la théorie de la tectonique des plaques mais le sujet est toujours en discussion. Soumises à une forte différence de température entre la base du manteau inférieur (isotherme 3 000 °C environ) d'une part et la transition asthénosphère-lithosphère (isotherme 1 330 °C) d'autre part, les roches du manteau développent un gradient de densité important. Les parties chaudes, moins denses, auront tendance à s'élever, tandis que les parties froides, plus denses, auront tendance à s'enfoncer.
Le moteur de la convection thermique est la poussée d'Archimède, due à la différence de masse volumique Δρ entre deux zones d'un même système. Le Δρ d'un système dépend de l'écart de température ΔT et du coefficient de dilatation thermique α . La poussée d'Archimède dépend de l'accélération de la pesanteur g et de Δρ ; elle dépend en fait du produit ΔT.α.g . Deux paramètres physiques vont s'opposer à la convection thermique : la viscosité cinématique ν qui s'oppose aux mouvements, et la diffusivité thermique κ qui limite les écarts de température. Plus un corps est visqueux, moins il se déformera. Et plus un corps a une diffusivité thermique élevée, moins il pourra s'établir de gradients de température et de masse volumique importants car la diffusion de chaleur par conduction limitera les écarts de température. On peut aussi montrer que la hauteur h d'un système favorise la convection : plus un système est mince, mieux la chaleur s'évacue par conduction ; plus il est épais, plus les mouvements de convection « ont de la place » pour s'établir. Rayleigh a montré que la « convectabilité » d'un système dépend de ces 6 facteurs : α , ΔT , g , h , κ et ν . Il a montré qu'elle dépendait du rapport:
Ra = α.ΔT.g.h³/κ.ν
Ce rapport est appelé depuis nombre de Rayleigh (Ra).
Le fluide chaud du bas va remonter de part sa densité plus faible et le corps froid descendre. Ils vont ainsi créer des mouvements de convections tel un tapis roulant.
Le convection s'amorce lorsque Ra dépasse une valeur critique. Tant que le Ra d'un système reste inférieur à 1000, seuil critique, l'immobilité de ce fluide persiste, quel que soit ce fluide. Quand ce nombre de Rayleigh est supérieur à environ 1000, la convection est privilégiée, sinon, c'est la conduction qui prime.
Ce nombre permet donc de vérifier (encore) la théorie de la tectonique des plaques. Le calcul du Ra du manteau permet de l'estimer à environ 100 millions, ce qui lui confère des caractéristiques très largement suffisantes à sa mise en mouvement.
Ces mouvements de convection créent à la surface du globe de nombreux phénomènes géologiques comme les dorsales. Ce sont des frontières de divergence entre deux plaques tectoniques qui s'écartent l'une de l'autre, c’est de cette façon que l’Islande est née. Les plaques eurasiatique et américaine surgissent au niveau de la dorsale atlantique et donc au niveau de l'Islande. Au niveau d'une dorsale, le magma sous la croûte fait surface, ce qui explique toute cette activité volcanique et le chauffage de l'eau des geysers.
De plus, le fait que les deux plaques composant l’Islande s’éloignent au fil du temps, l’île s’agrandit. Les calculs permettent de dire que les plaques s’éloignent de 2cm par an.

La convection thermique est le moteur de la mise en mouvement de ces plaques, elles se déplacent sur une couche de roche en fusion, du magma. C’est justement cette zone qui donne naissance à un autre type de volcanisme en Islande, celui des points chauds (mentionnés sur le schéma ci-dessus).
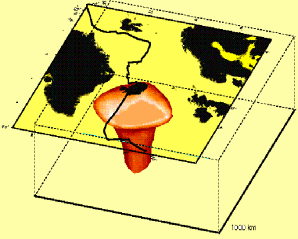
Le point chaud ne change pas de position tandis que la plaque où il se manifeste est en mouvement.
Ainsi un volcan apparaît, la plaque bouge, l'alimentation est stoppée et le volcan meurt. Un autre volcan apparaît un peu plus
loin à la verticale de la remontée de magma. Le phénomène se reproduit ainsi de proche en proche.
Le point chaud se manifeste en surface par l'apparition d'un volcan, le résultat final est un alignement de volcans d'autant plus anciens qu'ils sont éloignés du point chaud.
L'alignement de ces volcans permet de mettre en évidence la vitesse et la direction du mouvement des plaques par rapport au point chaud fixe. Cette dynamique est illustrée sur l'animation suivante.
Le volcanisme dit de "points chauds" est lié à des remontés de panaches thermiques enracinés profondément dans la planète. Ces panaches ascendants de roches solides peuvent «percer» la surface au milieu des océans ou des continents. Une fois à proximité de la surface, ils fondent partiellement et les liquides produits percent la croûte océanique ou continentale. Ce type de volcanisme est relativement rare (quelques dizaines de volcans au maximum). Ci-contre, le point chaud se situant juste en-dessous de l'Islande, plus précisément sous le massif du Vatnajökull. Cette situation unique engendre sur l'île une importante activité volcanique et géothermale, là où le magma est le plus près de la surface.
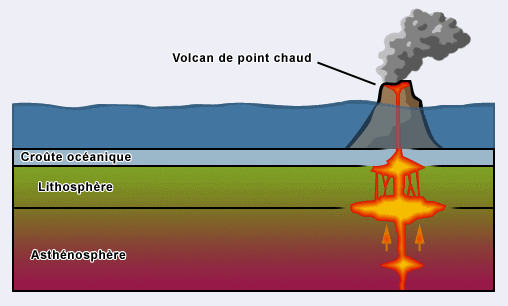
Conclusion Partielle:
Nous avons donc en Islande un croisement de deux types de volcanismes distincts: la dorsale océanique et le point chaud. La dorsale naît de l’écartement par convection de deux plaques tectoniques et entraîne la remontée à la surface du magma sous forme basaltique. Quant au point chaud, ce phénomène consiste à une remontée d’une poche de magma qui perce la croûte terrestre en créant des volcans. Ces volcanismes engendrent une proximité entre le magma et certaines zones comme les réservoirs d’eau souterraine des geysers.

